Prochain(s) événement(s)

25/09/2025 18:00Visio Conférence PDSI : Les grandes constellations de satellites, une innovation à réguler
Page en construction :
• 25 septembre : Pollution de l’espace (sur) avec Guy Perrin, astronome, qui évoquera son rapport à l'Académie des sciences : Les grandes constellations de satellites, une innovation à réguler - Pilotage Patrice Selosse (IESF) - CNES envisagé.
Guy Perrin est né en 1968 à Saint-Étienne. Ancien élève de l’École polytechnique, il a obtenu un doctorat en astrophysique et techniques spatiales de l’Université Paris 7 en 1997. Il est reconnu pour ses contributions significatives à l’astronomie et a été élu membre de l’Académie des sciences en 2022.
En 2015, il a reçu le Grand Prix scientifique Simone et Cino del Duca de l’Institut de France, suivi du Prix La Recherche en 2019 et du Prix Fizeau en 2020. En 2019, il a été nommé Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Guy Perrin est également astronome à l’Observatoire de Paris et a exprimé des préoccupations concernant la prolifération des satellites en orbite terrestre. Il a notamment mis en garde contre les impacts négatifs de cette expansion, tels que la pollution lumineuse et les risques de collision entre débris spatiaux.

Le rapport cosigné par Guy Perrin intitulé “Grandes Constellations de Satellites : Enjeux et Impacts”, publié le 30 mars 2024 par l’Académie des sciences, analyse les implications du déploiement massif de constellations de satellites en orbite basse, une innovation majeure du NewSpace.
Contexte et innovations technologiques
Le NewSpace se caractérise par l’émergence de nouveaux acteurs privés et l’utilisation de technologies avancées, permettant le déploiement de vastes réseaux de petits satellites. Ces constellations visent principalement à fournir des services de communication haut débit et d’observation de la Terre, remplaçant ou complétant les satellites géostationnaires traditionnels. Des entreprises comme SpaceX et Amazon jouent un rôle central dans cette transformation, combinant capacités de lancement, fabrication de satellites et services de télécommunications.
Avancées et opportunités
Ces réseaux satellitaires offrent une connectivité Internet à haut débit et faible latence partout sur le globe, y compris dans les zones reculées. Leur résilience supérieure aux infrastructures terrestres les rend particulièrement utiles en cas de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Les capacités d’observation en temps réel renforcent également les applications en géolocalisation et en surveillance environnementale.
Enjeux et préoccupations
Cependant, l’absence de régulation internationale adéquate suscite plusieurs inquiétudes :
• Impact sur l’astronomie : Les satellites réfléchissent la lumière solaire, perturbant les observations astronomiques optiques et infrarouges. En radioastronomie, les émissions des satellites créent des interférences nuisibles aux observations sensibles.
• Encombrement spatial et débris : La multiplication des satellites accroît le risque de collisions, générant des débris spatiaux. Cette situation pourrait mener à des réactions en chaîne de collisions, compromettant l’accès sûr à l’espace.
• Environnement atmosphérique : Les lancements fréquents émettent des polluants dans la haute atmosphère, notamment des particules de carbone, pouvant affecter la couche d’ozone et le bilan radiatif terrestre. De plus, la rentrée incontrôlée de satellites en fin de vie pose des risques environnementaux.
• Souveraineté et régulation : Les réseaux satellitaires privés échappent aux réglementations nationales applicables aux infrastructures terrestres, soulevant des questions de souveraineté et de sécurité des données.
Recommandations de l’Académie des sciences
Face à ces défis, l’Académie des sciences formule plusieurs recommandations :
• Renforcer les capacités européennes : Encourager le développement de technologies spatiales en Europe pour bénéficier des avancées tout en assurant une autonomie stratégique.
• Établir une régulation internationale : Mettre en place des cadres réglementaires garantissant un accès durable aux orbites et fréquences, tout en protégeant les domaines affectés, notamment l’astronomie et l’environnement.
• Promouvoir des pratiques responsables : Développer des codes de bonne conduite pour minimiser les impacts négatifs des constellations de satellites.
En conclusion, bien que les grandes constellations de satellites offrent des opportunités significatives, leur déploiement nécessite une régulation rigoureuse pour prévenir des conséquences potentiellement irréversibles sur l’environnement, la science et la souveraineté des États.














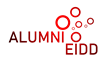




 Accès au répertoire IESF
Accès au répertoire IESF
